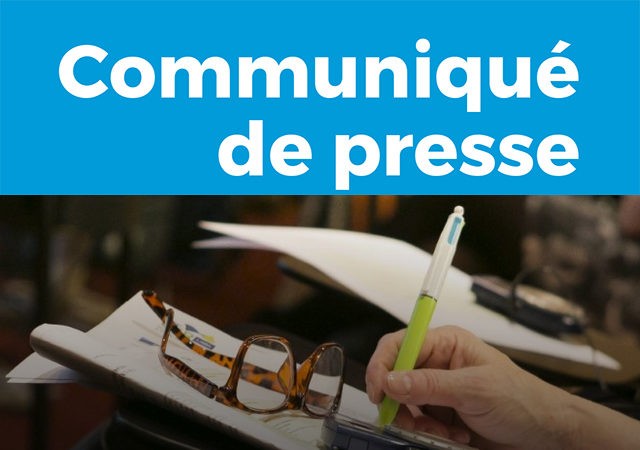Cadre de Ville – Que change la loi Ddadue s’agissant des modalités d’exemption de la dérogation « espèces protégées » ?
Clothilde Repeta – La loi Ddadue du 30 avril 2025 ajoute un nouvel alinéa à l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement, applicable à tous les porteurs de projet.
Deux conditions cumulatives permettent aujourd’hui de considérer que la délivrance d’une dérogation « espèces protégées » n’est pas requise, ce qui me semble aller dans le sens d’une sécurisation des projets.
La première condition impose que le projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé.
La seconde condition tient à ce que le projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
En d’autres termes, lorsque des relevés naturalistes auront révélé la présence d’espèces animales ou végétales protégées sur un terrain, il appartiendra au maître d’ouvrage de vérifier si les mesures d’évitement et de réduction (par exemple, l’adaptation du calendrier des travaux), permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas « suffisamment caractérisé ».
Mais aussi de s’assurer de l’effectivité de ces mesures par un dispositif de suivi.
CdV – Qu’est-ce que cela change en pratique, et des précautions particulières doivent-elles être prises par les porteurs de projet ?
CR – On le sait, la nécessité d’une dérogation « espèces protégées » ne fait pas l’objet d’un contrôle administratif préalable lorsqu’un projet immobilier n’est soumis qu’à la délivrance d’un permis de construire, et ne requiert pas une évaluation environnementale impliquant la réalisation d’une étude d’impact en amont.
En effet, le maire en sa qualité d’autorité compétente en matière d’urbanisme n’a pas à vérifier si un projet doit ou non faire l’objet d’une dérogation « espèces protégées ».
Et, en pratique, c’est parfois tardivement, lors de l’exécution de travaux, que la question se pose (ou se repose) de savoir si la dérogation est requise, après qu’un tiers, généralement une association de protection de l’environnement, a alerté la préfecture à ce sujet.
Dans ces conditions, on ne peut que recommander aux maîtres d’ouvrage, lors de la conception d’un projet susceptible de porter atteinte à des espèces protégées, de s’assurer du concours d’un bureau d’études pour rechercher leur présence dans la zone du projet, et déterminer si les conditions cumulatives désormais posées par L. 411-2-1 du Code de l’environnement peuvent être remplies.
En l’absence d’évaluation environnementale, et donc de dispositif ERC obligatoire, il leur est conseillé de le prévoir à titre volontaire dans la demande de permis de construire, en se rattachant si nécessaire à l’article R. 111-26 du Code de l’urbanisme, en vertu duquel un projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Car la question du dispositif de suivi devra faire l’objet d’une vigilance particulière des maîtres d’ouvrage.
Pour pouvoir continuer à bénéficier de l’exemption de l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement, ils pourront être amenés à adopter des mesures supplémentaires, même après la réalisation de leur projet, faute de quoi ils pourraient être contraints de déposer un dossier de demande de dérogation.
CdV – Le législateur reprend-il la jurisprudence du Conseil d’État, notamment son avis contentieux de 2022 ?
CR – Le nouvel alinéa de l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement entérine et complète les critères dégagés par le Conseil d’État dans son avis « Association Sud-Artois » du 9 décembre 2022.
Pour mémoire, le Conseil d’État a jugé, par cet avis, qu’un porteur de projet doit obtenir une dérogation uniquement « si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé ».
Et cela après avoir pris en compte les mesures d’évitement et de réduction des atteintes proposées par le pétitionnaire, lesquelles doivent présenter « les garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé ».
La première condition du nouvel aliéna de l’article L. 411-2-1 est donc la codification de cette jurisprudence.
La seconde condition, directement inspirée de la directive dite « RED III » de 2018 sur la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, va un cran plus loin que cet avis.
Elle impose, tout d’abord, au porteur de projet de mettre en place un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures des mesures d’évitement et de réduction prévues.
Il ne s’agit pas réellement d’une innovation car, pour les projets soumis à évaluation environnementale, l’article L. 122-1-1 du Code de l’environnement exige de façon générale d’assortir les mesures ERC de modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine.
Le nouveau texte impose ensuite « le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées ».
Là encore, ce n’est pas une nouveauté : dès lors que la dérogation fait l’objet d’un recours de plein contentieux, les mesures doivent être adaptées au fil du temps pour s’assurer du respect du dispositif de préservation des espèces protégées.
Si le nouveau texte se concentre sur la condition du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, l’exigence vaut également, en réalité, pour les garanties d’effectivité des mesures d’évitement et de réduction.
CdV – Le critère d’appréciation du « risque suffisamment caractérisé » est-il défini à cette occasion par le législateur ?
CR – Non. Le législateur ne revient pas sur la notion de « risque suffisamment caractérisé », issu de l’avis contentieux « Association Sud-Artois ».
Il faut en déduire qu’il laisse le soin au juge d’en définir les contours au gré des décisions rendues.
Et ce n’est pas une mauvaise chose en soi. À vouloir trop verrouiller les règles, on peut aboutir à des situations d’une grande rigidité.
Le critère du « risque suffisamment caractérisé » a fait déjà l’objet de plusieurs applications par le Conseil d’État et les juridictions du fond.
Il en ressort que le risque est apprécié en tenant compte des mesures d’évitement et de réduction prévues pour le projet, le juge considérant qu’il appartient à l’administration de s’assurer de leur effectivité.
Pour le dire autrement, la nécessité de la dérogation s’apprécie au vu des impacts résiduels d’un projet, indépendamment des mesures de compensation.
Dans différentes jurisprudences récentes, on voit que le juge prend en compte les enjeux de préservation des espèces en cause, ou encore sa « sensibilité » pour porter une appréciation du risque « suffisamment caractérisé » (par exemple, Conseil d’État, 18 novembre 2024, n° 487701, ce qui est cohérent avec le fait que l’atteinte à une espèce est difficilement séparable de sa situation dans la zone d’implantation du projet.
L’appréciation de ce critère nouveau mérite, toutefois, d’être encore précisé par le juge, qui pourra s’appuyer sur le dispositif de suivi et d’adaptation, désormais prévu à l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement.
Il convient enfin de noter que l’avis « Association Sud-Artois » indique que l’examen de la nécessité d’une dérogation s’impose « dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes ». La codification du régime de la dérogation espèces protégées ne remet pas en cause cet aspect important.
CdV – Une question prioritaire de constitutionnalité sur ce nouveau texte est-elle à prévoir ?
CR – C’est une question technique, mais il me semble que la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 29 avril 2025, notamment sur le nouvel alinéa à l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement, ne fait pas obstacle à la transmission d’une QPC.
Ainsi, le Conseil constitutionnel s’est prononcé dans le cadre d’un contrôle a priori sur la loi Ddadue, plusieurs députés contestant la place dans cette loi de l’article 23 insérant le nouvel alinéa à l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement.
Les députés requérants soutenaient que ces dispositions n’avaient pas leur place dans la loi, au motif qu’elles auraient été introduites en première lecture, selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution. Il s’agissait donc d’un grief d’ordre purement procédural.
La décision rendue par le Conseil constitutionnel ne me semble pas faire obstacle à ce qu’un requérant, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, présente une QPC portant sur la substance même du nouvel aliéna de l’article L. 411-2-1, en soutenant qu’il porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, point sur lequel la décision du 29 avril 2025 du Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcée.
Une QPC semble donc bien possible, notamment au regard de la Charte de l’environnement. Mais ses chances de succès paraissent faibles, au vu de la genèse de la disposition législative en question.
D’autres articles, publiés sur le site de Cadre de Ville, pourraient vous intéresser :
La Banque des Territoires mobilise 5 Md€ pour financer 75 000 logements étudiants d’ici 2030
Venise 2025 : le pavillon France s’invite hors les murs pour « vivre avec » un monde instable